Actualités
Dernières nouvelles


Crise humanitaire
04/04/2024
Kits de 1ers secours, eau et repas pour les ...
Plan International collabore avec des partenaires locaux pour fournir nourriture, eau et kits de 1ers secours aux habitant.e.s de ...
Keep reading

Ses loisirs
Rwanda
12/04/2024
Des jeunes Rwandaises poursuivent leurs ...
L'équipe cycliste Bike For Future remet en question les stéréotypes de genre à l'approche des championnats du monde de cyclisme ...
Keep reading
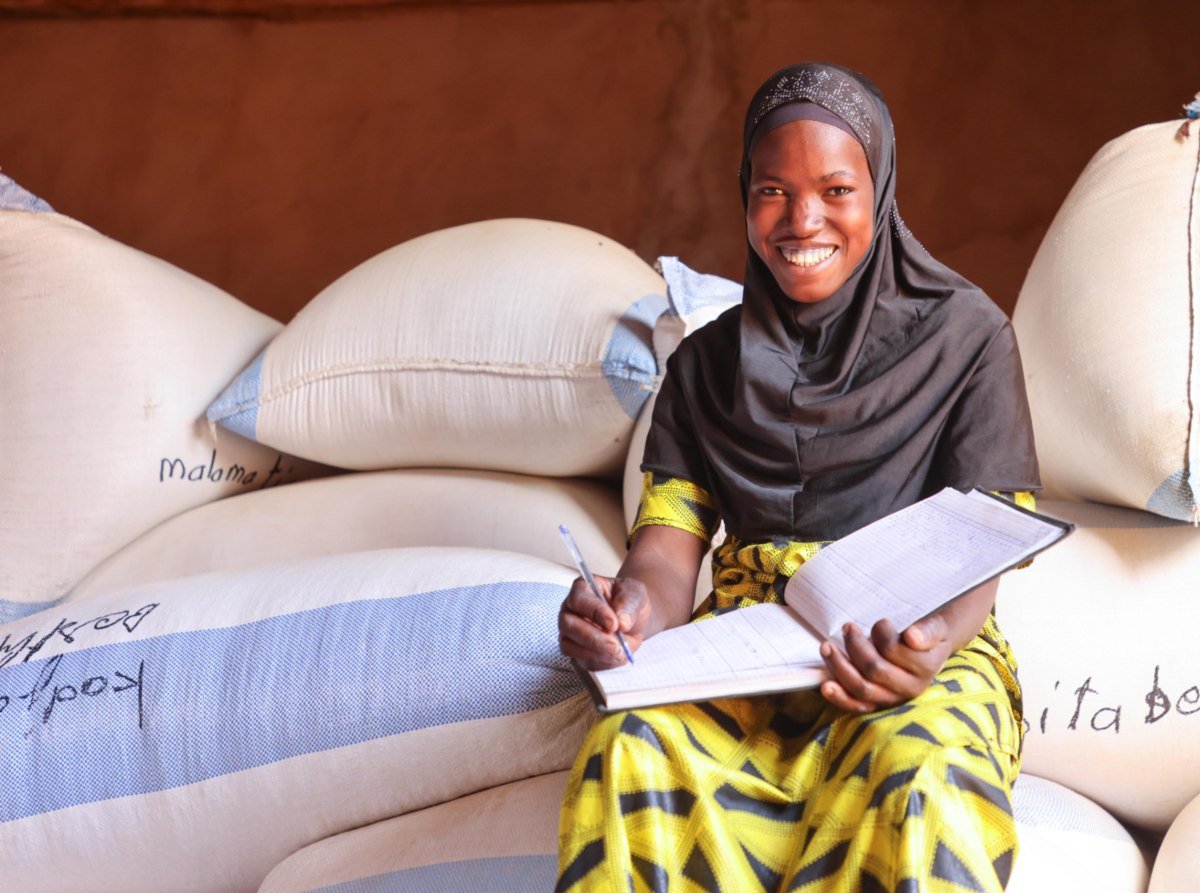
18/04/2024
Les Maliennes luttent contre la malnutrition ...
Depuis le début du projet, plus de 300 familles ont déjà utilisé les banques de céréales.
Keep reading
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
Stay up-to-date about our activities in Belgium and around the world
Dernières nouvelles
Support Plan International
Did you know that by contributing financially to our projects, you support girls'
freedom. From a contribution of €40 per year, you will receive a tax certificate with
which you will receive a refund of up to 45% of your contribution.





